C+
Fiche de Rendement du Québec

|
Section 1: Expérience de la pauvreté 

|
|||
|---|---|---|---|
| Indicateur | Donnés | 2024 Grade |
2023 Grade |
|
La situation des gens est moins bonne que l’an dernier
|
37.7% | B- |
B+ |
|
Personnes qui consacrent plus de 30 % de leur revenu au loyer
|
40.5% | F |
D+ |
|
Les bénéficiaires du soutien gouvernemental qui affirment que les taux sont insuffisants pour suivre le coût de la vie
|
44.4% | D |
C- |
|
Personnes ayant de la difficulté à accéder aux soins de santé
|
13.5% | C |
C |
|
Pourcentage du revenu consacré aux coûts fixes au-delà du loyer
|
54.6% | C+ |
D+ |
| Dans l'ensemble | D+ |
C |
|
|
Section 2: Mesures de la pauvreté 

|
|||
| Indicateur | Donnés | 2024 Grade |
2023 Grade |
|
Taux de pauvreté (MPC)
|
6.6% | C+ |
A- |
|
L’aide sociale provinciale en pourcentage du seuil de pauvreté (adultes vivant seuls)
|
89% | A |
|
|
L’aide aux personnes provinciale en situation de handicap en pourcentage du seuil de pauvreté
|
69% | C |
|
|
Taux de chômage
|
5% | D+ |
C |
|
Taux d’insécurité alimentaire
|
15.7% | B- |
A- |
| Dans l'ensemble | B- |
B+ |
|
|
Section 3: Défavorisation matérielle 

|
|||
| Indicateur | Donnés | 2024 Grade |
2023 Grade |
|
Niveau de vie inadéquat
|
30.2% | C- |
D+ |
|
Niveau de vie gravement inadéquat
|
20.8% | C+ |
D+ |
| Dans l'ensemble | C |
D+ |
|
|
Section 4: Progrès législatifs 

|
|||
| Indicateur | Donnés | 2024 Grade |
2023 Grade |
|
Progrès législatifs
|
B |
B |
|
| Dans l'ensemble | B |
B |
|

Si le Québec demeure au premier rang au pays au niveau des mesures de réduction de la pauvreté, l’écart qui le sépare des autres provinces se rétrécit. . Le Québec doit mettre davantage l’accent sur la réduction de la pauvreté en 2024 et continuer de faire preuve de leadership dans le secteur.

Aperçu de la pauvreté
Selon notre sondage national, la réduction du coût des aliments, l’amélioration des soins de santé et le logement abordable sont les enjeux les plus importants liés à la pauvreté au Québec. Alors que le taux de pauvreté de 6,6 % au Québec était inférieur à celui de l’ensemble du Canada (9,9 %), de nombreux habitants de la province peinent encore à joindre les deux bouts. En 2023, le nombre d’usagers des banques alimentaires du Québec a presque doublé par rapport à 2019.Le coût de la vie et le logement abordable
Entre décembre 2022 et décembre 2023, le prix global des biens et des services au Québec a augmenté de 4 %, comparativement à 3,4 % dans l’ensemble du Canada, selon l’Indice des prix à la consommation.Pauvreté et inégalité au Québec
Le Québec est aux prises avec des disparités socioéconomiques, des clivages linguistiques et des difficultés liées à l’intégration des immigrants. Les communautés autochtones, les personnes racisées et les groupes marginalisés sont confrontés à des obstacles en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux services sociaux. Bien que la tendance des taux de pauvreté inférieurs à la moyenne se confirme dans l’ensemble des communautés racisées au Québec, ces dernières affichent encore des taux de pauvreté beaucoup plus élevés que les communautés non racisées.Travail et éducation
Le taux d’activité dans la province est relativement élevé dans l’ensemble de la population active. Toutefois, les jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni employés, ni étudiants, ni stagiaires sont particulièrement exposés à un risque de pauvreté. En 2022, 10 % des jeunes du Québec étaient dans cette situation comparativement à 11 % dans l’ensemble du Canada. L’éducation est un facteur essentiel pour protéger la population contre la pauvreté. Parmi les adultes du Québec âgés de 25 à 64 ans, 14,5 % n’avaient pas de diplôme d’études secondaires ou équivalent, ce qui est supérieur au taux national de 11,6 %. Le taux était toutefois plus élevé chez les hommes au Québec, soit 17,3 %.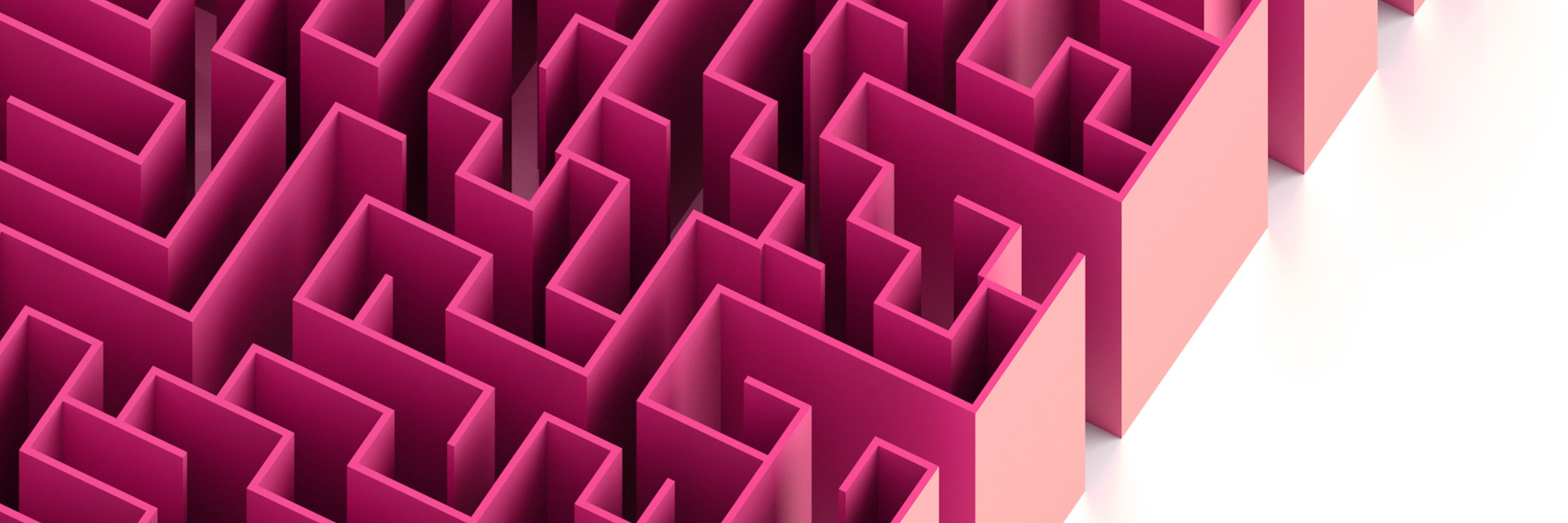
La pauvreté et l’insécurité alimentaire au Québec sont les plus faibles au Canada, notamment grâce à des décennies d’efforts stratégiques soutenus des gouvernements provinciaux successifs. Bien que ces efforts aient positionné le Québec comme un chef de file en matière de réduction de la pauvreté, la province ne doit pas se reposer sur ses lauriers.
Le Québec a
été la première juridiction canadienne à établir une stratégie de réduction de
la pauvreté. Cette stratégie a été présentée il y a plus de 20 ans et est
mise à jour tous les cinq ans. La stratégie révisée pour 2024-29 devrait
être publiée plus tard cette année.
Depuis le
début de la crise d’abordabilité, le gouvernement provincial a mis l’accent sur
trois mesures clés :
- 30 milliards de dollars sur
sept ans sous
forme de soutien financier et de mesures de réduction des impôts.
- Une augmentation importante du salaire minimum depuis 2022.
- Un plan d’investissement de
1,7 milliard de dollars pour construire environ 8 000 unités de nouveaux logements abordables.
Ces mesures
permettront d’alléger une partie du fardeau que vit la population à faible
revenu. Toutefois, elles ne correspondent pas aux ambitions des gouvernements
précédents en matière de lutte contre la pauvreté. La grande majorité du
programme de soutien financier du gouvernement prend la forme de réductions
d’impôt qui aident les ménages à revenu moyen et supérieur, même
si les personnes à faible revenu ont connu la baisse la plus importante du
niveau de vie pendant cette période. Seulement 1 % des
30 milliards de dollars alloués ont été affectés à l’augmentation des
allocations de logement, ce qui soutiendrait les personnes les plus vulnérables
de la province à un moment où l’abordabilité du logement s’est considérablement
aggravée.
L’approche du gouvernement en matière d’investissements dans
le logement a été tout aussi décevante. Les frais de logement pourraient bien
être beaucoup plus abordables au Québec que dans les autres provinces, mais les
investissements sont aussi insuffisants pour créer une nouvelle offre de
logements abordables. À un moment où l’écart d’offre de logements au Québec
augmente plutôt que diminue, la province ne dispose pas d’un cadre solide à
long terme pour stimuler la construction de nouveaux logements abordables.
L’annonce, l’automne dernier, d’un plan de construction de
8 000 logements a été largement motivée par le besoin politique
d’égaler les investissements fédéraux dans ce domaine provenant du Fonds
pour l’accélération du logement. Les 8 000 logements que la
province propose d’aider à construire correspondent à moins de 1 % de ce
qu’estime nécessaire la Société canadienne d’hypothèques et de logement
d’ici 2030. Le plan ne prévoit pas non plus d’investissement soutenu
au-delà de la période initiale, ce qui signifie que les municipalités et les
organismes sans but lucratif ne peuvent pas prendre de décisions de
planification à long terme. Si la province avait réaffecté ne serait-ce que 10 %
de ses mesures de soutien financier à la construction de logements abordables,
elle aurait été en mesure de soutenir près de 15 000 logements
supplémentaires au cours des prochaines années.
Dans le rapport de l’an dernier, nous avons exhorté la
province à envisager d’instaurer un soutien financier ciblé qui pourrait, au
fil du temps, se transformer en prestation alimentaire à faible revenu. Elle ne
l’a pas fait, préférant plutôt verser un paiement ponctuel d’abordabilité de
500 $ pour les familles gagnant moins de 100 000 $. Toutefois,
même si ces mesures de soutien temporaires prennent fin, le Québec continue
d’offrir les prestations
d’aide sociale les plus généreuses au pays.
Les paiements d’abordabilité, comme de nombreux autres
crédits et déductions, ont été versés par le biais du régime fiscal et exigent
que les résidents produisent une déclaration pour 2021. Le Québec a l’un
des taux de non-déclaration les plus bas au pays. Environ
6 % de la population ne produit pas de déclaration de revenus et
pourrait donc se voir refuser les prestations auxquelles elle pourrait avoir
droit. L’an dernier, le gouvernement provincial a annoncé son intention de
lancer un projet
pilote pour encourager et aider les résidents à faible revenu à produire
leur déclaration de revenus. Cela est conforme à l’objectif du gouvernement
fédéral, mais semble fonctionner plus lentement. Selon le Québec, il faudra
jusqu’à cinq ans pour évaluer si un système de déclaration automatique
devrait être mis en place de façon plus systématique afin d’augmenter davantage
les taux de déclaration pour tous les ménages.
Le budget provincial de 2024 prévoit un déficit de plus de
9 milliards de dollars, ce qui représente environ 1,5 % du PIB. En
réponse, la province s’est engagée à effectuer un examen important des dépenses
de programmes au cours des prochaines années dans l’espoir d’équilibrer
les comptes d’ici 2029-30. Bien que peu de détails sur cet examen des
dépenses aient été communiqués à ce jour, il existe un risque que cet examen
entraîne une diminution des investissements dans les politiques de réduction de
la pauvreté dans un avenir rapproché.
Même si le Québec présente le plus
faible niveau d’insécurité alimentaire modérée ou grave de toutes les provinces
et de tous les territoires, la crise d’abordabilité a fait
augmenter considérablement la demande dans les banques alimentaires et pour
l’aide alimentaire d’urgence.
Une tendance alarmante observée par les banques alimentaires
est le nombre croissant de visiteurs dont le revenu principal provient d’un
travail n’arrivant plus à couvrir toutes leurs dépenses. Les banques
alimentaires ont également constaté une augmentation de la demande de
travailleurs saisonniers et temporaires qui travaillent dans des usines comme
les usines d’emballage de poisson ou les fermes, ainsi que d’étudiants étrangers
et de nouveaux immigrants.
Le gouvernement provincial avait déjà fourni une aide
importante aux banques alimentaires, dont 23 millions de dollars l’an
dernier, et il a
récemment annoncé qu’il verserait 26 millions de dollars en 2024-2025.
Bien que cette aide accrue soit la bienvenue, elle ne permet pas aux centres de
planifier et de répondre aux besoins de leur clientèle locale; plus important
encore, elle s’attaque aux symptômes de la pauvreté plutôt qu’à ses causes
fondamentales.

Responsabilité
1. Élaborer une nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté dans le but ambitieux de mettre fin à la pauvreté d’ici 2030.Le Québec ayant réduit de près des deux tiers le taux de pauvreté, passant de 13,5 % en 2015 à 5,2 % en 2021, il pourrait le ramener à près de zéro. Mais cela nécessitera un leadership fort. Un axe prioritaire précoce et réalisable de la stratégie pourrait être l’offre de prestations pour les familles. Le soutien du revenu provincial et les autres transferts correspondent déjà à 92 % du seuil de pauvreté fixé par la mesure du panier de consommation pour un couple avec deux enfants, et à 81 % pour les familles monoparentales avec un enfant.
Logements abordables
2. Accélérer la construction de logements locatifs abordables spécialisés.Bien que la province ait récemment annoncé de nouveaux investissements dans la construction de logements abordables, elle manque de financement soutenu à long terme ainsi qu’à une échelle qui fera une réelle différence. Nous recommandons de réserver trois milliards de dollars supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Cela équivaudrait à seulement 10 % de l’engagement actuel du gouvernement en matière de réductions d’impôt et de soutien financier et contribuerait à construire près de 15 000 logements de plus que ce que la province prévoit d’aider à construire actuellement. Toute réduction d’impôt future devrait idéalement être axée sur les familles à faible revenu et donner lieu à un placement de 10 % dans le logement. Cela sera plus efficace à long terme pour favoriser une abordabilité financièrement responsable et économiquement avantageuse.
Coût de la vie et travail décent
3. Faire du salaire minimum un salaire de subsistance.Le salaire minimum au Québec est toujours inférieur d’au moins 1 $ l’heure à celui de l’Ontario. Les récentes augmentations n’ont pas suffi à le transformer en salaire de subsistance. Le gouvernement du Québec devrait adopter une politique pour agir rapidement afin d’égaler le salaire minimum en Ontario et travailler plus fort pour établir une politique de salaire de subsistance. Un salaire minimum égal à celui de l’Ontario permettrait d’augmenter considérablement le revenu des travailleurs à faible revenu sans compromettre la compétitivité ou l’emploi.
4. Élargir le perfectionnement des compétences et créer des voies d’accès aux métiers et aux bons emplois.La province devrait élaborer une stratégie pour élargir considérablement les possibilités de perfectionnement et de recyclage des compétences pour les adultes qui ont déjà obtenu des niveaux d’apprentissage plus élevés. Pour appuyer notre recommandation d’accroître les investissements dans la construction de logements abordables, ce programme pourrait d’abord viser à encourager un plus grand nombre de travailleurs à se lancer dans les métiers de la construction. Cela contribuerait à créer davantage d’emplois bien rémunérés pour les travailleurs qui risquent de vivre dans la pauvreté et à établir une base solide d’abordabilité du logement dont toute la population peut bénéficier.
5. Établir la parité pour l’aide sociale aux personnes handicapées.Le Québec est la seule province au pays où les personnes handicapées reçoivent moins d’aide (près de 5 000 $ de moins) que les personnes qui sont en mesure d’intégrer le marché du travail. Cet écart s’ajoute aux défis auxquels font déjà face les personnes handicapées. Nous recommandons à la province d’harmoniser les prestations d’aide aux personnes handicapées aux prestations d’aide aux personnes sans handicap.
FICHE DE RENDEMENT
- Placez le curseur sur les provinces ou territoires pour voir un aperçu de leur note respective.
- Cliquez sur les provinces ou territoires pour afficher l’aperçu de leur fiche de rendement sur la pauvreté.
- Pour en savoir plus sur la note globale, le contexte, l’orientation politique, les perspectives et les recommandations politiques, cliquez sur Afficher la fiche de rendement.
Ces notes représentent la mesure dans laquelle les efforts de réduction de la pauvreté des gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral sont efficaces. Comme plusieurs facteurs contribuent à la pauvreté, tels que les coûts du logement et des besoins quotidiens ainsi que la qualité du filet de sécurité sociale, ces fiches de rendement évalueront l’expérience de la pauvreté partout au Canada et les mesures que peuvent prendre les gouvernements pour améliorer leurs politiques sociales.
Les provinces et les territoires sont comparés les uns avec les autres pour évaluer l’expérience de la pauvreté, les mesures de la pauvreté, le niveau de vie et le progrès du gouvernement dans l’adoption d’une loi anti-pauvreté. Cette approche aide les décideurs politiques et les défenseurs à comparer les résultats des gouvernements, à cerner les politiques qui fonctionnent bien à l’échelle nationale et à disposer de données probantes pour promouvoir des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté.
Il s’agit d’un outil évolutif qui sera mis à jour chaque année pour suivre les progrès réalisés par les gouvernements dans la réduction de la pauvreté.
A
B
C
D
F
INC
Inconclusive
En tant qu’organisme qui soutient un réseau d’associations d’un bout à l’autre du pays, Banques alimentaires Canada reconnaît que ses activités sont exercées sur les territoires traditionnels des peuples autochtones qui ont pris depuis des temps immémoriaux soin de ces terres que nous appelons maintenant le Canada.
Nous reconnaissons que bon nombre d’entre nous sont des colonisateurs et que ces terres sur lesquelles nous vivons, travaillons, échangeons et voyageons sont assujetties à l’autonomie gouvernementale des Premières Nations en vertu de traités modernes, de territoires non cédés et non abandonnés, ou de territoires traditionnels desquels les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits ont été déplacés.
Nous nous engageons à décoloniser et à démanteler les systèmes d’oppression qui ont dépossédé et continuent de déposséder les peuples autochtones de leurs terres et de les priver de leurs droits inhérents à l’autodétermination. Il s’agit notamment d’évaluer le rôle que Banques alimentaires Canada a joué dans la perpétuation de ces systèmes et de travailler à devenir des partenaires actifs dans la voie de la réconciliation.